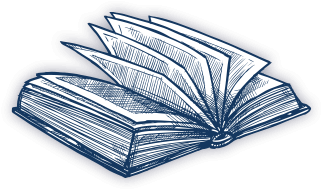Nos documents
Mise en contexte : Qu’est-ce que la révolution industrielle?
La révolution industrielle commence en Angleterre et en France à la fin du 18e siècle, transformant profondément les méthodes et les lieux de production, ainsi que les conditions de travail. Grâce à la machine à vapeur, on passe d’une production artisanale, où des artisans spécialisés produisent des objets en petites quantités, à une production industrielle, où des ouvriers non spécialisés fabriquent des produits en grande quantité
Auteur inconnu, Stephenson's Rocket drawing (1829), Mechanics magazine (repéré via Wikimedia Commons). Licence : domaine public.
Source du texte :
Service national du RÉCIT, domaine de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : L'industrialisation : organisateurs graphiques
Partager ce document en utilisant ce lien
Amorce
Qui? Qui vois-tu sur les images?
Quand? À quelle époque (année, siècle, période, etc.) se déroulent les faits représentés sur l’image?
Comment? De quelle façon l’objet est-il fabriqué?
En observant les images, quel changement peux-tu observer en ce qui concerne la méthode de travail?
Selon toi, laquelle des méthodes de travail illustrées est encore utilisée de nos jours pour fabriquer les objets de ton quotidien?
Ce document fait partie du dossier : L'industrialisation : organisateurs graphiques
Partager ce document en utilisant ce lien
Définir un concept particulier : mode de production
Associer les concepts aux images et définitions correspondantes.
Ce document fait partie du dossier : L'industrialisation : organisateurs graphiques
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 1 : Le train
Au début du 19e siècle, la locomotive à vapeur et les chemins de fer se développent rapidement en Angleterre. En 1840, le pays ne compte que 1349 km de voies ferrées, mais en 1880, ce chiffre dépasse les 30 000 km, facilitant ainsi le transport terrestre de marchandises et de personnes.
Auteur inconnu, Blenkinsop's rack locomotive Salamanca (1829), The Mechanic's Magazine (repéré via Wikimedia Commons), licence : domaine public.
Source du texte :
Service national du RÉCIT, domaine de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : L'industrialisation : organisateurs graphiques
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 2 : La classe ouvrière
Pour les propriétaires d’usines, l’ouvrier est considéré comme une simple force de travail qui échange son labeur contre un salaire. Souvent peu qualifiés et donc facilement remplaçables, ils reçoivent des salaires très bas, à peine suffisants pour subvenir à leurs besoins.
Dans les familles ouvrières les plus pauvres, il est courant que les femmes et les enfants travaillent aussi en usine. Ils reçoivent des salaires encore plus faibles que ceux des hommes.
Frank Meadow Sutcliffe, Workmen Leaving Platt's Works (1900), Wikimedia Commons, Licence : domaine public.
Source du texte :
Service national du RÉCIT, domaine de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : L'industrialisation : organisateurs graphiques
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 3 : Exode rural et urbanisation
Dans la seconde moitié du 18e siècle, de nombreux paysans anglais perdent accès à la terre à cause des lois de l’enclosure.
Privés de moyens, les paysans des zones rurales se dirigent en masse vers les villes où ils espèrent trouver un emploi. Ils logent alors dans des quartiers ouvriers. Situés près des usines, les quartiers ouvriers ne possèdent que rarement les commodités que sont l’eau courante, les services de ramassage des déchets et un système d’aqueduc. Ils sont donc souvent affectés par des maladies de toutes sortes et la mortalité infantile y est élevée.
C. Lodge, Victorian Bishopgate, (1906) Wikimedia Commons, Licence : Creative Commons (BY-SA).
Source du texte :
Service national du RÉCIT, domaine de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : L'industrialisation : organisateurs graphiques
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 4 : La bourgeoisie industrielle
La révolution industrielle contribue à l’émergence d’une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie industrielle. Grâce à sa richesse, celle-ci possède les moyens de production que sont les usines et manufactures.
La bourgeoisie industrielle engage une main-d'œuvre ouvrière, en échange d’un faible salaire. Leur objectif est de dégager un profit, afin de le réinvestir dans les moyens de production, puis de dégager un plus grand profit.
Wm. Notman & Son, F. J. Francis et un ami (1895), Musée McCord, II-109450. Licence : Domaine public.
Source du texte :
Service national du RÉCIT, domaine de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : L'industrialisation : organisateurs graphiques
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 5 : Le charbon
Dans la seconde moitié du 19e siècle, les usines ont besoin d'une source d'énergie pour alimenter les machines à vapeur, ainsi que pour chauffer et éclairer leurs installations. Elles se tournent alors vers le charbon, une ressource abondante en Angleterre. Pour répondre à la demande énergétique croissante, les mines se multiplient partout sur le territoire.
J Cobden, A hurrier and two thrusters moving a corf full of coal (1853), Wikimedia Commons, Licence : domaine public.
Source du texte :
Service national du RÉCIT, domaine de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : L'industrialisation : organisateurs graphiques
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 6 : Les syndicats
Pendant la révolution industrielle, les ouvriers travaillent souvent dans des conditions difficiles avec des salaires insuffisants. Pour améliorer leurs conditions de travail, ils rejoignent des syndicats. Bien que ces organisations, dédiées à la défense des travailleurs, soient initialement illégales, elles finissent par obtenir une reconnaissance légale grâce à de nombreuses grèves et manifestations. Ce mouvement permet aux ouvriers d'améliorer progressivement leur bien-être.
Auteur inconnu, Cartoon showing police brutality against the match makers' demonstration (1871), The Days' Doings (repéré via Wikimedia Commons), License : domaine public.
Source du texte :
Service national du RÉCIT, domaine de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : L'industrialisation : organisateurs graphiques
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 7 : Les premières banques
Vers la fin du 18e siècle, les premières banques font leur apparition. Les propriétaires d'industries peuvent alors emprunter d’importantes sommes à crédit pour investir dans les machines et les infrastructures. Cela permet d'augmenter la production de leur entreprise et de générer davantage de profit dont une partie pourra être réinvestie. Quand cette somme est réinvestie dans les moyens de production d’une entreprise, elle est appelée le capital.
Auteur inconnu, Bank of England (1797), Wikimedia commons. Licence : image du domaine public.
Source du texte :
Service national du RÉCIT, domaine de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : L'industrialisation : organisateurs graphiques
Partager ce document en utilisant ce lien
Les causes de la Conférence de Berlin (1884-1885)
En 1884-1885, les représentants de 13 États européens et des États-Unis se réunissent à Berlin à l’invitation du chef d’État allemand Otto von Bismarck. Ils établissent des règles sur la colonisation du continent africain afin de réduire les conflits entre les puissances européennes concurrentes. C’est lors de cette conférence que le Congo est octroyé au roi belge Léopold II.
TV5 Monde, « Ce jour-là » La conférence de Berlin », Youtube, en ligne.
Source du texte :
Service national du RÉCIT, domaine de l'univers social.
AMORCE : Un premier président noir
Un premier président noir
« Quand Barack Obama naissait le 4 août 1961, la plupart des Noirs ne votaient pas aux États-Unis. C’est dire la longue marche des Noirs pour la liberté et l’égalité. Obama candidat ou président démocrate élu à la Maison-Blanche témoigne certainement de l’évolution des mentalités par rapport à la question raciale aux États-Unis. Mais attention! Ce n'est pas et ce ne sera pas la Fin de l'Histoire. [...] Par ailleurs, le fait qu'un Afro-Américain devienne président ne serait pas synonyme de progrès pour l'ensemble de la communauté noire aux États-Unis. Mais cela s'appelle l'espoir. Et c'est beaucoup. »
Question : Selon toi, est-ce que l’arrivée de Barack Obama au pouvoir signifie la fin des inégalités raciales aux États-Unis?
Pete Souza (photographe officiel de la Maison blanche), Président Barack Obama (2012), Wikimedia Commons. Licence : image du domaine public.
Source du texte :
Yao Assogba, « La longue marche des Noirs américains pour la liberté et l'égalité », Le Droit, section Opinion, 21 octobre 2008.
Ce document fait partie du dossier : La reconnaissance des droits des Noirs aux États-Unis
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 1 : Des sit-in
Des sit-in
« Autre objet de lutte : les pratiques ségrégationnistes dans les restaurants. Dans un restaurant pour les Blancs ou dans une section du restaurant réservée aux Blancs, les pacifistes noirs s’assoient et attendent que quelqu’un vienne prendre leur commande. Invariablement, le propriétaire appelle la police, qui les déloge et les expulse. Puis, ils reviennent au même restaurant, toujours plus nombreux, attendre d’être servis. La vague de sit-in commence le premier février 1960, à Greensboro, en Caroline du Nord, lorsque quatre étudiants noirs refusent de quitter le comptoir de lunch d’un magasin Woolworth réservé aux Blancs. En septembre 1961, plus de 70 000 étudiants, noirs et blancs, auront participé à un ou plusieurs sit-in. »
Jack Moebes / Greensboro-News Record, Le sit-in de Greensboro (1960), UNC School of Education. Licence : Creative Commons (BY-NC-SA).
Source du texte :
Lise Pothier, Histoire des États-Unis, Mont-Royal, Modulo Éditeur, 1987, p. 431.
Ce document fait partie du dossier : La reconnaissance des droits des Noirs aux États-Unis
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 2 : Des lois contre la ségrégation
Des lois contre la ségrégation
La lutte pour les droits des Noirs obtient de grands succès dans les années 1950 et 1960. Le gouvernement fédéral adopte plusieurs lois pour garantir une plus grande égalité aux Noirs, dont voici les principales :
- 1957 : loi interdisant la ségrégation en matière électorale.
- 1961 : loi interdisant la ségrégation dans les transports routiers.
- 1964 : loi interdisant la discrimination basée sur la race, la couleur, la religion ou le sexe (Civil Rights Act).
- 1968 : loi interdisant la ségrégation dans le logement.
Dans les faits, l’application de ces lois s’avère souvent difficile et longue à réaliser.
Cecil Stoughton, Signature du Civil Rights Act de 1964 aux États-Unis, Wikimedia Commons. Licence : image du domaine public.
Source du texte :
Service national du RÉCIT, domaine de l’univers social
Ce document fait partie du dossier : La reconnaissance des droits des Noirs aux États-Unis
Partager ce document en utilisant ce lien
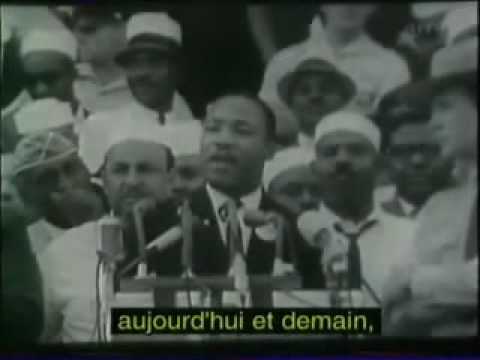
Document 3 : J’ai fait un rêve...
J’ai fait un rêve...
Le 28 août 1963, environ 250 000 personnes participent à la marche vers Washington pour le travail et la liberté. Les principales organisations de défense des droits des Noirs, organisatrices de l’événement, formulent à cette occasion des demandes spécifiques :
- que cesse la ségrégation raciale dans les écoles publiques;
- que des lois significatives soient adoptées pour garantir les droits civiques des Noirs, notamment dans le monde du travail;
- qu’un salaire minimum de 2$ de l’heure soit accordé à tous les travailleurs sans distinction;
- que les activistes des droits civiques soient protégés de la violence policière.
De plus, c’est à l’occasion de cette marche que le pasteur Martin Luther Jr. prononce son célèbre discours « J’ai fait un rêve » que tu peux regarder en cliquant ICI.
Martin Luther King Jr., I have a dream (1963, sous-titré en français), YouTube et Service national du RÉCIT, domaine de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : La reconnaissance des droits des Noirs aux États-Unis
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 4 : L’affaire Rosa Parks
L’affaire Rosa Parks
Le 1er décembre 1955, Rosa Parks, une jeune couturière de l’Alabama, prend place à l’avant d’un autobus de la ville de Montgomery. Or, cette section est réservée uniquement aux Blancs. Malgré les demandes répétées du conducteur, elle refuse de céder sa place à un passager blanc. Elle finit par se faire arrêter par la police et reçoit une amende de 15$ qu’elle conteste. Pour la soutenir, le pasteur Martin Luther King Jr., un partisan des moyens d’action non violents, organise une campagne de boycottage contre la compagnie d’autobus. Cette campagne se poursuit pendant 381 jours. En novembre 1956, la Cour suprême déclare que la ségrégation raciale dans les autobus va à l’encontre de la Constitution des États-Unis.
United Press Photo, Rosa Parks assise à l’avant de l’autobus, regardant par la fenêtre (21 décembre 1956), Library of Congress, LC-USZ62-111235. Licence : image du domaine public.
Source du texte :
André Kaspi, Les Américains, tome 2 : Les États-Unis de 1945 à nos jours, Paris, Éditions du Seuil, 1986, p. 462-463.
Ce document fait partie du dossier : La reconnaissance des droits des Noirs aux États-Unis
Partager ce document en utilisant ce lien
Amorce : À chacun sa part
À chacun sa part
En 1884-1885, les représentants de 13 nations européennes et des États-Unis se réunissent à Berlin à l’invitation du chef d’État allemand Otto von Bismarck. Ils établissent des règles sur la colonisation du continent africain afin de réduire les conflits entre les puissances européennes concurrentes. C’est lors de cette conférence que le Congo est octroyé au roi belge Léopold II.
Question : Observe la caricature ci-contre. Comment peux-tu l’interpréter?
Draner, « Découpage de l’Afrique à la conférence de Berlin », Journal L'Illustration (1885), Wikimedia Commons. Licence : image du domaine public.
Ce document fait partie du dossier : Les Empires coloniaux
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 1 : Les missionnaires au Congo
Les missionnaires au Congo
Dans les années 1890, le gouvernement belge délègue à des communautés religieuses le soin d’éduquer les enfants abandonnés ou orphelins. Pour les soutenir dans leur tâche, il leur concède des terres de 200 à 300 hectares et leur offre des subventions. En contrepartie, les missionnaires enseignent aux enfants le français, la lecture, l’écriture, les bases du christianisme, ainsi qu’une formation pratique (par exemple en agriculture ou en agronomie forestière). Par ces oeuvres d’éducation, ils préparent des ouvriers, des infirmiers et commis pour les services publics. Ils diffusent les valeurs chrétiennes et exercent une grande influence sur les habitants les plus éduqués du Congo belge. Cette assimilation de la culture et des valeurs européennes est ce qu’on nomme l’acculturation.
« Les soeurs de Kimuenza », dans René Vauthier, Le Congo Belge : notes et impressions, Bruxelles, J. Lebègue, 1900, p. 145.
Source du texte :
Service national du RÉCIT de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : Les Empires coloniaux
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 2 : Henry Morton Stanley au service de Sa Majesté
Henry Morton Stanley au service de Sa Majesté
En 1879, l’explorateur Henry Morton Stanley se rend au Congo pour le compte du roi Léopold II. Sa mission : aider le roi à prendre possession de la colonie. En cinq ans, il fait signer plus de 400 traités à des chefs indigènes qui cèdent ainsi leurs terres à la Belgique.
« Le mot “traité” était un euphémisme*, car de nombreux chefs n’avaient aucune idée claire de ce qu’ils signaient. Rares étaient ceux qui avaient vu auparavant un mot écrit, et on leur demandait d’apposer un X sur un document en langue étrangère et rédigé dans le jargon [langage] des juristes. [...] ils ne pouvaient concevoir celle [l’idée] de céder par écrit leur terre à quelqu’un habitant de l’autre côté de l’océan. [...] En échange d’ ”une pièce de tissu par mois pour chacun des deux chefs” [...] ils promirent d’“abandonner librement et de leur propre assentiment* [...] tous les droits de souveraineté et de gouvernement de tous leurs territoires. [...]
Les morceaux d’étoffe de Stanley n’achetaient pas seulement la terre, mais [aussi] la main d’oeuvre. »
*Euphémisme : atténuation d’une idée déplaisante.
*Assentiment : avec leur accord.
London Stereoscopic & Photographic Company, Carte de visite : Mr Stanley (1872), Wikimedia Commons. Licence : image du domaine public.
Source du texte :
Adam Hochschild, Les Fantômes du roi Léopold, Paris, Texto, 2007, p. 126-127.
Ce document fait partie du dossier : Les Empires coloniaux
Partager ce document en utilisant ce lien

AMORCE : La production chinoise
La production chinoise
Regarde le reportage dont le lien se trouve ICI et réponds aux questions qui suivent :
- Où est située l’usine de textile ?
- Pourquoi les Chinois établissent-ils leurs usines à cet endroit?
- Comment sont produits les biens de consommation dans cette usine chinoise?
- Comment se caractérisent les conditions de vie des ouvriers ?
- À ton avis, ce type de production est-il nouveau?
France 2, « Éthiopie : l’atelier de la Chine », 20 heures, 10 octobre 2012, YouTube.
Ce document fait partie du dossier : L'industrialisation
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 3 : La colonisation de l’Afrique
La colonisation de l’Afrique
Au 19e siècle, les puissances européennes se livrent une féroce concurrence pour démontrer leur puissance et leur supériorité. Cette rivalité se joue en partie sur le continent africain, où les pays européens cherchent à dominer le plus grand nombre de colonies. C’est ce que démontre la carte ci-contre.
George Langlois et Karelle Savaria, L’Afrique coloniale en 1914, Centre collégial de développement de matériel didactique. Licence : utilisation permise dans un contexte éducatif et non commercial.
Source du texte :
Service national du RÉCIT de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : Les Empires coloniaux
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 5 : La ségrégation raciale
La ségrégation raciale
« [Jusqu’au début des années 1960], la ségrégation raciale continue de s’imposer dans les États du Sud et dans ceux qui “bordent” la frontière avec le Nord et l’Ouest. Des lois interdisent les mariages qualifiés de “mixtes”, réglementent la séparation des races dans les écoles et dans les bâtiments publics. Avec ou sans loi, un Noir ne peut entrer chez un Blanc du sud qu’en empruntant la porte de derrière, doit descendre du trottoir lorsqu’il croise un Blanc, balaie le magasin mais ne sert pas les clients blancs, peut faire un shampooing à une cliente blanche mais non lui mettre les bigoudis.
Bref, le code de conduite qui régit les relations entre Noirs et Blancs descend dans les détails les plus sordides, et qu’il soit écrit ou tacite, conforte les pratiques discriminatoires. »
Question : Qu’indique l’affiche au centre de la photo?
Marion Post Wolcott, Magasins de vêtements d’occasion et les prêteurs sur gages sur Beale Street, Memphis, Tennessee, Library of Congress, LC-DIG-ppmsc-00197. Licence : image du domaine public.
Source du texte :
Service national du RÉCIT, domaine de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : La reconnaissance des droits des Noirs aux États-Unis
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 6 : Des écarts persistants
Des écarts persistants
« La période de lutte pour l’égalité des droits a permis plusieurs avancées dans le domaine économique. [...] La conjonction des changements économiques et politiques des années 1960 et 1970 a entraîné une plus grande mobilité économique et procuré plus d’opportunités professionnelles à une partie considérable de la population noire. [...] La brusque ascension sociale du tiers de la population noire environ qui a pu profiter des opportunités qui lui étaient offertes d’améliorer sa situation et ses conditions de vie a eu comme effet pervers de laisser derrière lui un groupe important de Noirs au plus bas de l’échelle sociale, fragmentant ainsi un peu plus l’unité de l’Amérique noire. »
Toni Frissell, Deux hommes noirs assis sur un perron de Charleston en Caroline du Sud (1962), Library of Congress, LC-USZC4-12119. Licence : image du domaine public.
Source du texte :
David Diallo, Histoire des Noirs aux États-Unis, Paris, Ellipses Édition, 2012, p. 121-123.
Ce document fait partie du dossier : La reconnaissance des droits des Noirs aux États-Unis
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 7 : Les tensions
Les tensions
« En 1964, la tension raciale est en effet telle que le moindre incident entre Noirs et Blancs donne invariablement lieu à un véritable déchaînement de violence. C’est par exemple le cas à Newark et à Detroit où des faits divers racistes donnent instantanément lieu à de violentes émeutes qui, par un phénomène de réaction en chaîne, se propagent rapidement dans les communautés voisines. Ces éruptions de violence se répètent tous les étés et à travers tout le pays, de la Floride à Cleveland en passant par Watts, Chicago, ou la région de New York, jusqu’en 1970. »
Dick De Marsico, Incident à la 133e rue et la septième avenue à Harlem (1964), Library of Congress, LC-USZ62-136894. Licence : image du domaine public.
Source du texte :
David Diallo, Histoire des Noirs aux États-Unis, Paris, Ellipses, 2012, p. 86.
Ce document fait partie du dossier : La reconnaissance des droits des Noirs aux États-Unis
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 4 : L’exploitation économique d’une colonie par la métropole
L’exploitation économique d’une colonie par la métropole
Service national du RÉCIT, domaine de l'univers social. Licence : Creative Commons (BY-NC-SA).
Ce document fait partie du dossier : Les Empires coloniaux
Partager ce document en utilisant ce lien

Document 1 : Germinal
Source : Claude Berri, Germinal, France, 1993, YouTube.
Ce document fait partie du dossier : L'industrialisation
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 5 : Les objectifs de la colonisation
Les objectifs de la colonisation
Voici un extrait de la correspondance du ministre des Colonies de la Belgique, Louis Franck :
«Que faisons-nous au Congo? Nous y poursuivons un double but : répandre la civilisation, développer les débouchés et l’action économique de la Belgique. Ces buts sont inséparables.
Sans une population indigène plus portée au travail, mieux protégée contre les maladies, plus nombreuse, mieux outillée de capacité technique plus grande, mieux vêtue, mieux nourrie, mieux logée, de conceptions morales plus élevées, nous n’arriverions pas à dégager de notre empire africain sa magnifique puissance de richesse. C’est avec les Noirs que nous y parviendrons, pour leur plus grand bien comme pour le nôtre. »
Exercices de la mitrailleuse Maxim, AP.0.0.544, collection du Musée royal de l’Afrique centrale. Licence : image du domaine public.
Source du texte :
Louis Franck, Recueil à l’usage des fonctionnaires et des agents du service territorial, 1920 cité dans Isidore Ndaywel à Nziem, Histoire générale du Congo, Paris/Bruxelles, De Boek et Larzier, 1998, p. 362.
Ce document fait partie du dossier : Les Empires coloniaux
Partager ce document en utilisant ce lien

Document 2 : Il était une fois le train
Il était une fois le train
- À quel moment se déroule cet extrait?
- Quels moyens techniques sont illustrés dans cet extrait de documentaire?
- En quoi sont-ils nouveaux à cette époque?
- D’où proviennent ces moyens techniques?
- Quelles conséquences ces moyens techniques ont-ils sur le transport des voyageurs et des marchandises?
Frédéric Antoine, Révolution industrielle - Train à vapeur, YouTube.
Ce document fait partie du dossier : L'industrialisation
Partager ce document en utilisant ce lien