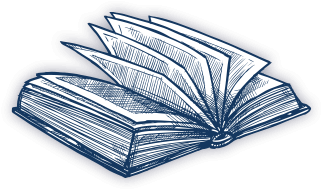Nos documents
Amorce : Comment maintenir un Empire aussi vaste?
Comment maintenir un Empire aussi vaste? Comment maintenir la Pax Romana? Comment romaniser l’Empire?
C’est par des victoires militaires que Rome a pu étendre son territoire et imposer sa culture. Lis les deux extraits suivants. À ton avis, est-ce que les Romains sont les bienvenus dans les provinces conquises?
Les Romains : des pilleurs! (Le discours de Gralgacus, dirigeant de la lutte des Bretons)
« Voleurs qui ont pillé l'univers [...]. Nos parents, nos enfants, ce que nous avons de plus cher au monde, ils (les Romains) les prennent pour les enrôler et les faire servir à l'étranger. Nos biens, nos fortunes sont absorbés par les impôts, nos blés par les réquisitions; vos bras, vos corps s'usent à percer des forêts, à combler des marais sous le fouet et l'injure ».
Tacite, Agricola, XXX-XXXI, né en 55 ap J.-C. et décédé en 117 ap. J.-C.
L'empereur romain Trajan
« Quelle joie pour toutes les provinces d'être placées sous notre protection et notre domination [. . .]
Il (l’Empire) relie l'Orient et l'Occident par des convois qui vont et viennent, si bien que tous les peuples apprennent à connaître, alternativement, ce qu'ils produisent et ce qui leur manque et comprennent qu'il est plus avantageux de n'avoir qu'un seul maître à servir ».
Pline le Jeune, Panégyrique de Trajan, 32, (100 ap. J.-C.)
George Langlois et Gilles Villemure, L’expansion territoriale de l’Empire romain (44 av. J.-C. - IIIe siècle), Centre collégial de développement de matériel didactique. Licence : utilisation permise dans un contexte éducatif et non commercial.
Source du texte :
Pline le Jeune, Panégyrique de Trajan, 32, (100 ap. J.-C.).
Ce document fait partie du dossier : Rome et romaniser l'Empire
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 1 : Tous les chemins mènent à Rome
Tous les chemins mènent à Rome
Au maximum de son expansion, l’Empire romain dispose d'un réseau routier de plus de 80 000 kilomètres couvrant l'équivalent d'une trentaine de pays actuels. Ces routes ont été construites par les soldats pour se déplacer rapidement vers les territoires à conquérir ou à protéger. On y circule à pied, à dos de cheval ou de mulet, ou en charrette.
Au début, la route a une fonction militaire. Puis, peu à peu, tous ceux qui ont besoin de se rendre dans les nombreuses régions de l’Empire y circulent. Les commerçants utilisent aussi ce système routier pour le transport des marchandises. Ce réseau de communication permet la diffusion des coutumes, des lois et de la culture romaine dans les villes de tout l’Empire.
Le réseau de communication de l’Empire romain au 2e siècle ap. J.-C., RÉCIT national de l’univers social.Licence : Creative Commons (BY-NC-SA).
Source du texte :
Service national du RÉCIT de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : Rome et romaniser l'Empire
Partager ce document en utilisant ce lien
AMORCE : Qu’est-ce que la démocratie?
Qu’est-ce que la démocratie?
La démocratie est un régime politique qui fait appel à trois caractéristiques essentielles :
-
la liberté : pouvoir d’agir et de s’exprimer librement;
-
l’égalité : pouvoir de jouir des mêmes droits et obligations que tous;
-
la représentativité : pouvoir de donner son opinion par soi-même ou par le biais d’un représentant élu.
Selon toi, quelles images illustrent le mieux le concept de démocratie?
1- Service national du RÉCIT, domaine de l'univers social, Bulletin de vote. Licence : Creative Commons (BY-NC-SA). 2- Jean-Jacques-François Le Barbier, La Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen (1789), Wikimedia Commons. Licence : image du domaine public. 3- Hyacinthe Rigaud, Portrait du roi Louis XIV en costume du sacre (1701). Musée du Louvre, Wikimedia Commons. Licence : image du domaine public. 4- Charles Russell, Défilé des troupes SA devant Hitler (1935), Wikimedia Commons. Licence : image du domaine public. 5- Manifestation devant le Parlement, Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale. Licence : avec l’autorisation de l’AIMTA.
Ce document fait partie du dossier : La démocratie à Athènes
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 1 : Institutions politiques athéniennes
Service national du RÉCIT, domaine de l'univers social. Licence : Creative Commons (BY-NC-SA).
Ce document fait partie du dossier : La démocratie à Athènes
Partager ce document en utilisant ce lien
Amorce : Le téléphone arabe en Mésopotamie
Le téléphone arabe en Mésopotamie
L’écriture est définie comme « Représentation, à l’aide de signes graphiques établis de façon conventionnelle, de la parole, de la pensée. » (Antidote, 2014). Selon toi, quel est l’impact de l’écriture sur l’organisation d’une société? Comment vit-on en société sans l’écriture?
Expérimente le jeu du téléphone arabe avec tes collègues de classe. Est-ce que les phrases dites au début de la chaîne arrivent intactes à la fin? Imagine si les transactions commerciales étaient effectuées ainsi ou encore si la loi était basée seulement sur des ententes verbales!
La société mésopotamienne a été transformée par l’écriture, mais sais-tu de quelle manière? Les documents historiques qui te sont présentés te permettront justement de répondre à cette question : Quelles sont les conséquences de l’apparition de l’écriture sur la civilisation mésopotamienne?
Service national du RÉCIT, domaine de l'univers social. Licence : Creative Commons (BY-NC-SA).
Source du texte :
Service national du RÉCIT, domaine de l'univers social. Licence : Creative Commons (BY-NC-SA).
Ce document fait partie du dossier : L’influence de l’écriture dans la civilisation mésopotamienne
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 1 : La naissance de l’écriture
La naissance de l’écriture
« L’écriture, née très humblement pour des besoins de simple comptabilité, est peu à peu devenue chez les habitants de la Mésopotamie un aide-mémoire, puis une manière de garder des traces de la langue parlée; et surtout une autre façon de la communiquer et même de penser et de s’exprimer. C’est ainsi que les [Mésopotamiens] ont inventé la correspondance, le courrier, et même les enveloppes en argile! Parmi mille autres prolongements notables, l’écriture cunéiforme permit de transcrire les hymnes religieux, les formules divinatoires, et ce qu’il est convenu de nommer la littérature. »
Service national du RÉCIT, domaine de l'univers social. Licence : Creative Commons (BY-NC-SA).
Source du texte :
G. Jean, L’écriture, mémoire des hommes, Paris, Gallimard, 1987, p. 18.
Ce document fait partie du dossier : L’influence de l’écriture dans la civilisation mésopotamienne
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 2 : Du pain et des jeux!
Du pain et des jeux!
50 000 personnes peuvent venir assister aux combats de gladiateurs dans le Colisée de Rome alors que le Circus Maximus (Grand cirque) peut accueillir près de 350 000 amateurs de courses de chars. Ces immenses édifices publics présents aussi dans de grandes villes des provinces romaines ont une vocation culturelle.
Les différents jeux sont organisés dans le cadre d’évènements religieux et politiques. L’État s’assure ainsi la faveur des dieux et surtout celle de la population. En effet, l’élite politique se sert surtout des jeux pour accroitre sa popularité auprès de l’opinion publique. Le peuple veut du pain et des jeux!
Andreas Ribbefjord, Le Colisée de Rome (2003), Wikimedia Commons. Licence : Creative Commons (BY-SA).
Source du texte :
Service national du RÉCIT de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : Rome et romaniser l'Empire
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 2 : Les enfants d’Athènes
Les enfants d’Athènes
À Athènes, les enfants n'ont pas le droit de participer à la vie politique de l'ecclésia.
Toutefois, les enfants de citoyens ont le droit, voire le privilège, de recevoir une éducation alors que les enfants de métèques et d’esclaves n’ont pas cette chance. Jusqu'à l’âge de sept ans, les enfants de citoyens, garçons et filles, reçoivent la même éducation de leur mère au gynécée. Puis, les filles poursuivent leur éducation avec leur mère alors que les garçons sont instruits par des maîtres privés.
Vers l'âge de 14 ans, les filles doivent apprendre tout ce qu'il faut pour devenir une bonne épouse et prendre mari.
À partir de 14 ans, les garçons s’exercent à des sports et participent à des épreuves athlétiques. Ils écoutent aussi les enseignements des philosophes, composent des discours et s’entraînent à les présenter. Ils s’exercent à débattre afin de devenir de bons citoyens. À 18 ans, ils débutent leur formation militaire qui durera deux ans.
Service national du RÉCIT, domaine de l'univers social. Licence : Creative Commons (BY-NC-SA).
Source du texte :
Service national du RÉCIT, domaine de l'univers social. Licence : Creative Commons (BY-NC-SA).
Ce document fait partie du dossier : La démocratie à Athènes
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 2 : Extraits du Code d’Hammourabi (vers 1750 av. J.-C.)
Extraits du Code d’Hammourabi (vers 1750 av. J.-C.)
On retrouve, sur le Code d’Hammourabi, 282 articles de loi qui réglementent plusieurs aspects de la société dont le droit pénal, le commerce, le mariage, l’architecture et les travaux agricoles. Les stèles comme celle-ci sont un moyen de diffusion des lois et cela permet au gouvernement de les appliquer uniformément.
Voici certains de ces articles :
« 21. Si un homme est entré par effraction dans une maison, on le tuera et pendra en face de cette brèche.
195. Si un fils a frappé son père, on lui coupera la main.
196. Si un homme a crevé l’oeil d’un homme libre, on lui crèvera un oeil.
198. S’il a crevé l’oeil d’un muskenu (un homme pauvre), ou brisé le membre d’un muskenu, il paiera une mine d’argent. »
Stèle du Code d’Hammourabi (vers 1750 av. J.-C.), Paris, musée du Louvre, Wikimedia Commons. Licence : image du domaine public.
Source du texte :
Extrait du Code d’Hammourabi (vers 1750 av. J.-C.) dans J. Imbert, G. Sautel, M. Bordet-Sautet, Histoires des institutions et des faits sociaux : des origines au Xe siècle, Paris, Thémis, 1963, p. 10-13; 18-22.
Ce document fait partie du dossier : L’influence de l’écriture dans la civilisation mésopotamienne
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 3 : L’écriture et le pouvoir
L’écriture et le pouvoir
Le roi dirige l’administration de la Cité-État qui siège au palais. L’administration des Cités-États a pu se développer grâce à l’écriture. En effet, le roi peut plus facilement prélever des taxes, garder un inventaire des ressources de la Cité-État et faire appliquer la justice.
Les scribes travaillent pour le roi et forment un groupe fort important dans la société mésopotamienne puisqu’ils sont les spécialistes de l’écriture. Cette compétence leur permet de travailler dans les temples, les écoles et les palais. Ils sont chargés de mettre par écrit les directives du roi et de consigner les informations pertinentes à l’administration.
Observe le haut du coin gauche de l’illustration. Cette partie de l’image illustre bien la relation qui existe entre le roi et les scribes.
Pillage de Musasir (à partir d'un bas-relief assyrien), Wikimedia Commons. Modifications par le service national du RÉCIT, domaine de l'univers social. Licence : Creative Commons (BY-NC-SA).
Source du texte :
Service national du RÉCIT de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : L’influence de l’écriture dans la civilisation mésopotamienne
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 3 : Les métèques
Les métèques
Dans la Grèce antique, ceux qui habitent Athènes sans y être nés sont appelés métèques. Ce sont des étrangers. La plupart sont des artisans ou des commerçants. Certains d'entre eux sont très riches. C'est sur eux que repose la prospérité économique d'Athènes.
Ils sont obligés de payer des taxes et des impôts et de faire leur service militaire, comme les citoyens. Cependant, aucun métèque ne peut acheter ou posséder une terre ou une maison. Ils n'ont aucun droit politique dans la société athénienne.
Le vendeur de thon (4e siècle av. J.-C.), Musée Mandralisca.
Source du texte :
Service national du RÉCIT de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : La démocratie à Athènes
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 3 : Un Empire commercial
Un Empire commercial
« À chaque saison de l'année, surtout à l'automne, tant de navires de transport viennent aborder au quai du Tibre que Rome est comme le marché universel du monde.
Les cargaisons venues de l'Inde et de l’Arabie heureuse, on peut les voir ici en grande quantité. Les tissus de Babylone et les bijoux des pays barbares* les plus lointains arrivent à Rome en grand nombre et facilement. Vos champs ce sont l'Égypte, la Sicile, la partie cultivée de l'Afrique. On peut dire que ce que l'on n'a jamais vu ici n'existe pas ou n'a jamais existé ».
*Barbare : mot qui désigne les peuples résidant à l’extérieur de l’Empire romain.
L’acheminement des ressources naturelles de l’Empire romain au 2e siècle ap. J.-C., RÉCIT national de l’univers social. Licence : Creative Commons (BY-NC-SA).
Source du texte :
D'après un discours d'Aelius Aristide, Éloge de Rome (2e siècle ap. J.-C.), cité dans Denise Galloy et Franz Hayt, Le monde romain, Bruxelles, De Boek, 1995, p. 37.
Ce document fait partie du dossier : Rome et romaniser l'Empire
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 4 : L’empereur, le chef de l’Empire
L’empereur, le chef de l’Empire
À l'époque de l'Empire, c'est l'empereur qui devient le dépositaire du pouvoir. Il est le chef de l'armée et possède un droit de véto* sur le sénat dont il nomme les membres. Il est aussi chef de la religion. Il contrôle la frappe de la monnaie. Il est entouré d'un conseil privé et d’une administration impériale dirigée par des hauts fonctionnaires qui dépendent de lui. Dans chacune des provinces conquises, un gouverneur le représente. Il administre le territoire, assure sa défense, la justice et perçoit les impôts.
*Droit de véto : droit à l’opposition d’une décision.
Lionel Royer, Vercingetorix dépose les armes aux pieds de César qui deviendra empereur de Rome (1899), Musée Crozatier, Wikimedia Commons. Licence : image du domaine public.
Source du texte :
Service national du RÉCIT de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : Rome et romaniser l'Empire
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 4 : Les citoyens d’Athènes
Les citoyens d’Athènes
Le citoyen doit être un homme libre, il doit avoir plus de 18 ans et doit être né à Athènes de parents citoyens athéniens.
Les citoyens sont les individus qui possèdent le plus de droits dans la société athénienne, particulièrement dans le domaine politique. Tous peuvent participer à l’assemblée du peuple, l’ecclésia. Dans les faits, seuls ceux qui sont assez à l'aise financièrement pour s'absenter de leur travail le font. Comme la majorité des citoyens sont des paysans, ils peuvent difficilement quitter leurs terres pour participer à l'ecclésia. Évidemment, ils ont aussi des devoirs à remplir. Ils doivent faire leur service militaire et payer des impôts.
Service national du RÉCIT, domaine de l'univers social. Licence : Creative Commons (BY-NC-SA).
Source du texte :
Service national du RÉCIT, domaine de l'univers social. Licence : Creative Commons (BY-NC-SA).
Ce document fait partie du dossier : La démocratie à Athènes
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 5 : Les esclaves
Les esclaves
Les esclaves n'ont aucun droit politique. Dans la plupart des cas, ce sont des prisonniers ramenés de la guerre. Ce sont aussi les enfants d'esclaves. Ils peuvent être vendus au marché comme de la marchandise et appartiennent à leur propriétaire.
Voici ce que le philosophe Aristote écrit sur les esclaves au 4e siècle av. J.-C. :
« Parmi les instruments, les uns sont animés, les autres inanimés [...] car, dans le travail, celui qui aide n'est qu'une sorte d'instrument [...]. L'esclave est un instrument vivant, [...] il n'y a guère de différence entre les esclaves et les animaux; pour les nécessités de la vie quotidienne, nous recourons à la fois aux esclaves et aux animaux domestiques. »
Peintre d’Antiménès, L'agriculture, principale activité utilisant des esclaves (vers 520 av. J.-C.), Wikimedia Commons. Licence : image du domaine public.
Source du texte :
Aristote, Politique (4e siècle av. J.-C.), I, 2. En ligne.
Ce document fait partie du dossier : La démocratie à Athènes
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 5 : Le Forum romain
Le Forum romain
Dans chaque province de l’Empire, l’État construit et entretient plusieurs édifices publics comme les thermes* et les latrines** qui ont des vocations sanitaires. Certains ont une vocation politique comme les forums. Le Forum romain sert de lieu de rassemblement des citoyens romains. Il est le centre politique et économique de la ville, donc un lieu de rencontres et d'échanges. Chaque grande ville romaine possède son forum où siège le gouverneur, le représentant de l’empereur.
*Thermes : établissement comprenant des bains privés ou publics.
**Latrines : toilettes publiques romaines.
Jean-Pierre Dalbéra, Le Forum romain (2011), Wikimedia Commons. Licence : Creative Commons (BY-SA).
Source du texte :
Service national du RÉCIT de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : Rome et romaniser l'Empire
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 6 : La tablette de comptabilité (3300 av. J.-C.)
La tablette de comptabilité (3300 av. J.-C.)
Avec l’expansion du commerce et des cités, les commerçants échangent un volume de plus en plus important de marchandises. Pour garder la trace des marchandises, les marchands développent peu à peu un système plus complexe d’inventaire. En utilisant des plaques d’argile, ils tracent des symboles représentant les marchandises et les quantités. Ces tablettes de comptabilité représentent le premier pas dans le développement de l’écriture cunéiforme*.
*Écriture cunéiforme : écriture en forme de coins, employée dans la Mésopotamie de l’Antiquité.
Tablette issue des archives administratives du temple de Ba'u à Lagash, photo de Marie-Lan Nguyen (2011), Paris, musée du Louvre, Wikimedia Commons. Licence : image du domaine public.
Document 6 : Institutions politiques athéniennes, un exemple à suivre
Institutions politiques athéniennes, un exemple à suivre
En 451 av. J.-C., Périclès, un grand homme d'état athénien, est élu au poste important de stratège d’Athènes. Réélu quinze fois consécutives, ce chef militaire s’impose dans la vie politique athénienne. L’historien Thucydide prête ce discours à Périclès :
« Notre constitution politique n’a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins; loin d’imiter les autres nous donnons l’exemple à suivre. Du fait que l’État, chez nous, est administré dans l’intérêt de la masse et non d’une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. Pour les affaires privées, l’égalité est assurée à tous par les lois; [...] »
Philipp Foltz, Oraison funèbre de Périclès (1877),Wikimedia Commons. Licence : image du domaine public.
Source du texte :
Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse (5e siècle av. J.-C.), II, 36-43.
Ce document fait partie du dossier : La démocratie à Athènes
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 7 : Les femmes
Les femmes
Dans la société athénienne, les femmes, qu’elles soient épouses d'un citoyen, métèques ou esclaves, n'ont aucun droit politique, légal ou social. Elles sont considérées comme des biens.
La femme de citoyens peut cependant transmettre la citoyenneté à leur fils, si elles sont nées d'un père et d'une mère citoyens. Elles sont exclues de la vie politique, mais ce sont elles qui dirigent l'organisation domestique. Elles demeurent au gynécée, s'occupent des enfants, supervisent le travail des esclaves et ne sortent de la maison que pour des occasions spéciales ou des fêtes religieuses. Par contre, les femmes de citoyens moins riches et qui ont moins d'esclaves, peuvent sortir pour faire leurs courses elles-mêmes.
La femme métèque a plus de libertés : elle peut voyager et travailler. Certaines possèdent même des commerces.
Les femmes esclaves ont été vendues à des familles riches et sont à leur service. En échange du gîte et de la nourriture, elles accomplissent les tâches ménagères et s'occupent des enfants.
Peintre de Brygos, Femme filant (vers 490 av. J.-C.), Wikimedia Commons (photo de Marie-Lan Nguyen). Licence : Creative Commons (CC-BY).
Source du texte :
Service national du RÉCIT de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : La démocratie à Athènes
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 6 : La langue et la religion
La langue et la religion
La langue est l’un des principaux véhicules d'une culture. Les Romains imposent leur langue, le latin, comme moyen de communication officiel dans tout l’Empire. Ils diffusent aussi leur vision du monde grâce à leur langue et leurs institutions.
Ils le font aussi à l’aide de la religion. En intégrant les dieux des provinces conquises à leur propre religion, ils permettent ainsi aux différentes cultures de s’intégrer à l’Empire. Partout sur le territoire, les Romains construisent des temples dédiés à toutes les divinités. Ce n’est que plus tard que Rome imposera le christianisme.
Jean-Pol Grandmont, Le Panthéon (2011), Wikimedia Commons. Licence : Creative Commons (BY-SA).
Source du texte :
Service national du RÉCIT de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : Rome et romaniser l'Empire
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 7 : L’armée
L’armée
Si l'Empire romain a pu atteindre une si vaste étendue, c'est grâce à une armée disciplinée et bien entraînée. D'une guerre à l'autre, d'un territoire à un autre, l'armée a attaqué les peuples des régions voisines, puis de régions de plus en plus éloignées. L'expansion territoriale une fois atteinte, l'armée s’est chargée d’assurer la sécurité et la protection des limes*, les frontières de l'Empire.
*Limes : système de fortifications sur certaines frontières. Il s'agit d'une route qui s'appuie sur des forts et des camps. Le mur d'Hadrien en Bretagne en est un bon exemple.
Une armée moderne? L’équipement du soldat romain, RÉCIT national de l’univers social.Licence : Creative Commons (BY-NC-SA).
Source du texte :
Service national du RÉCIT de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : Rome et romaniser l'Empire
Partager ce document en utilisant ce lien

Document 4 : Le calculi (4000 av. J.-C. à 3000 av. J.-C.)
Le calculi (4000 av. J.-C. à 3000 av. J.-C.)
Les marchands mésopotamiens échangent fréquemment les produits de l’agriculture locale et de l’artisanat (principalement du textile) contre des matériaux des régions voisines.
Un vaste réseau commercial se développe et les échanges ont principalement lieu dans des ports et des marchés qu’on appelle kârum. Les marchands ont été parmi les premiers à utiliser des formes d’écriture pour identifier les produits. Cette première forme d’écriture, qu’on appelle le calculi, consiste en une boule d’argile dans laquelle on insère des jetons. La forme, le nombre et le matériau des jetons correspondent au type et à la quantité de marchandises. C’est donc avant tout pour des raisons commerciales que prend forme la première écriture.
Visionne cette vidéo qui traite de la naissance de l’écriture en Mésopotamie.
Source du texte :
Service national du RÉCIT de l’univers social.
Ce document fait partie du dossier : L’influence de l’écriture dans la civilisation mésopotamienne
Partager ce document en utilisant ce lien
Document 5 : L’Épopée de Gilgamesh (1800 av. J.-C. à 700 av. J.-C.)
L’Épopée de Gilgamesh (1800 av. J.-C. à 700 av. J.-C.)
L’Épopée de Gilgamesh raconte l’histoire d’un roi légendaire de Mésopotamie. Ce texte a été modifié et augmenté à plusieurs reprises au cours de l’histoire en plus d’être traduit en plusieurs langues. Les archéologues en ont également trouvé des copies à différents endroits, ce qui montre qu’il était largement diffusé. Voici un extrait de ce texte :
« Uta-napisti expliqua donc à Gilgamesh :
Gilgamesh, je vais te révéler un mystère, je vais te confier le secret des dieux!
Tu connais la ville de Suruppak, sise [sur le bord] de l’Euphrate, Vieille cité, et que les dieux hantaient.
C’est là que prit aux grands-dieux l’envie de provoquer le Déluge [...]
Démolis ta maison pour te faire un bateau;
Renonce à tes richesses pour te sauver la vie;
Détourne-toi de tes biens pour te garder sain et sauf!
Mais embarque avec toi des spécimens de tous les êtres vivants! »
La tablette du déluge (7e siècle av. J.-C.), photo de BabelStone (2010), Londres, British Museum, Wikimedia Commons. Licence : image du domaine public.
Source du texte :
Extrait de l’épopée de Gilgamesh dans J. Bottéro, S.N. Kramer, Lorsque les dieux faisaient l’homme : Mythologie mésopotamienne, Paris, Gallimard, 1989, p. 568-569.
Ce document fait partie du dossier : L’influence de l’écriture dans la civilisation mésopotamienne
Partager ce document en utilisant ce lien
Le développement de l'écriture
« L’écriture, née très humblement pour des besoins de simple comptabilité, est peu à peu devenue chez les habitants de la Mésopotamie un aide-mémoire, puis une manière de garder des traces de la langue parlée; et surtout une autre façon de la communiquer et même de penser et de s’exprimer. C’est ainsi que les [Mésopotamiens] ont inventé la correspondance, le courrier, et même les enveloppes en argile! Parmi mille autres prolongements notables, l’écriture cunéiforme permit de transcrire les hymnes religieux, les formules divinatoires, et ce qu’il est convenu de nommer la littérature. »
Svdmolen, Babylonian numerals (2004.), Wikimedia Commons. Licence : image du domaine public.
Source du texte :
G. Jean, « L’écriture, mémoire des hommes », Paris, Gallimard, 1987, p. 18
Le calculi
Les marchands mésopotamiens échangent fréquemment les produits de l’agriculture locale et de l’artisanat (principalement du textile) contre des matériaux des régions voisines.
Un vaste réseau commercial se développe et les échanges ont principalement lieu dans des ports et des marchés qu’on appelle kârum. Les marchands ont été parmi les premiers à utiliser des formes d’écriture pour identifier les produits. Cette première forme d’écriture, qu’on appelle le calculi, consiste en une boule d’argile dans laquelle on insère des jetons. La forme, le nombre et le matériau des jetons correspondent au type et à la quantité de marchandises. C’est donc avant tout pour des raisons commerciales que prend forme la première écriture.
Franck Raux, Bulle enveloppe et calculi, Musée du Louvre. Licence : Creative Commons BY-NC 3.0
Source du texte :
Service national du RÉCIT, domaine de l'univers social
Calculer la dimension des terres
En Mésopotamie, on notait les dimensions des terrains de l’État ou des particuliers sur des tablettes d’argiles afin de délimiter les propriétés ou pour déterminer le montant des impôts.
La première trace connue de l’utilisation du cadastre* date du 4e millénaire avant notre ère et provient de la cité-État de Dunghi. Sur ce dernier, on retrouvait le plan de la cité-État, sa superficie ainsi que la description des activités de la ville.
*Cadastre : registre, sous forme de plan, des différentes propriétés d'un territoire.
Oussama Shukir Muhammed Amin FRCP, Un texte de cadastre écrit en akkadien. Tablette en terre cuite. XVIIIe siècle avant notre ère. De Sippar, Irak. Musée de l'Orient antique, Istanbul, Wikimedia Commons. Licence : Creative Common (BY-SA 4.0).
Source du texte :
Service national du RÉCIT, domaine de l’univers social.
Une économie méditerranéenne
Située à proximité de la Méditerranée, la cité-État d’Athènes est reliée à son port, le Pirée, par un long corridor fortifié de 8 kilomètres.
Grâce à ce corridor, les marchandises en provenance et à destination des colonies grecques méditerranéennes pouvaient circuler de manière sécuritaire entre les cités.
Le port du Pirée, bien qu’il ait une fonction économique très importante, permettait de stationner plus de 200 trières grecques*. Ces navires de guerre, rapides et légers, éperonnaient les navires ennemis afin de les couler.
*Vaisseaux de guerre
Napoleon Vier, The Long Walls connecting the ancient city of Athens to its port of Piraeus. (2007), Wikimedia Commons. Licence : image du domaine public.
Source du texte :
Service national du RÉCIT, domaine de l'univers social.
La mythologie et les valeurs grecques
Dans la mythologie grecque antique, Héra est la protectrice des femmes et la déesse du mariage, gardienne de la fécondité du couple et des femmes enceintes. Il s'agit d'une déesse ayant une forte influence sur les citoyens. En effet, cette déesse évoque la nécessité de concevoir un enfant dans les liens du mariage. Autrement, un enfant conçu hors de ces liens n'aurait pas la possibilité de faire partie de la Polis*.
Les valeurs transmises par la mythologie guident ainsi les comportements à adopter dans l’Antiquité grecque.
*Polis : Communauté des citoyens
ArchaiOptix, Héra sur une fresque antique de Pompéi (2018), Wikimedia Commons, Licence : Creative Commons (BY-SA 4.0).
Source du texte :
Service national du RÉCIT, domaine de l'univers social.